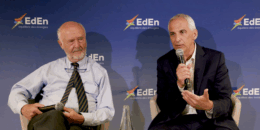Augmentation de la population, développement humain, tensions géopolitiques, acceptabilité sociale et changement climatique : c’est cette équation tout entière qui est contenue dans la transition énergétique. Portée par une population qui atteindra 9,7 milliards d’habitants et une amélioration du niveau de vie dans les pays émergents, la demande mondiale d’énergie primaire augmentera de 30 % d’ici 2050. Dans le même temps, l’urgence climatique nécessite de décarboner les systèmes énergétiques.
Face à ces enjeux multiples, trois grands blocs se distinguent.
Les États-Unis sont devenus en une décennie le premier producteur mondial de pétrole et de gaz naturel liquéfié, lui procurant un avantage compétitif. L’Inflation Reduction Act a amplifié cette dynamique en stimulant l’innovation dans la décarbonation. Grâce aux écosystèmes existants, comme le réseau de transport de CO2 pour la production de pétrole (EOR1), les pétroliers nord-américains accélèrent cette transformation avec des projets de séquestration de CO2 et d’hydrogène bleu. L’alternance politique américaine impulse une volonté d’Energy Dominance qui soutiendra en fait l’essor de toutes les énergies, y compris décarbonées.
La Chine contrôle désormais les chaînes de valeur stratégiques de la transition. Elle assure plus de 95 % de la production mondiale des cellules photovoltaïques, 75 % des batteries lithium-ion et 85 % du raffinage des métaux rares. Cette domination sur les technologies bas carbone soutient sa compétitivité industrielle et s’accompagne d’une approche pragmatique sur l’usage des énergies fossiles – dont le charbon qui ne décline toujours pas – afin de préserver sa sécurité énergétique.
Entre ces deux géants, l’Union européenne, pionnière dans son ambition Net Zero 2050, est confrontée aux limites de son déterminisme technologique et aux contraintes économiques. Les coûts énergétiques, deux à cinq fois supérieurs à ceux des États-Unis, pèsent sur la compétitivité de l’industrie européenne, laquelle peine à suivre le rythme de la transition, tandis que les consommateurs supportent mal les coûts qui y sont associés. En outre, la complexité réglementaire et la densité des territoires entravent l’essor des énergies renouvelables.
Lire aussi : Vers une industrie zéro net : l’UE à la hauteur du défi ?
La transition énergétique nécessite une révision des priorités avec plus de pragmatisme : neutralité technologique, priorité aux solutions de transition selon leur coût pour le consommateur. Pour ce faire, l’UE doit privilégier les solutions d’ores et déjà disponibles pour la décarbonation de la génération électrique (renouvelables, gaz et batteries, nucléaire, hydroélectricité), de la mobilité terrestre et de la chaleur résidentielle et industrielle, sans chercher à privilégier les solutions idéales pour atteindre le Net Zero. Nous devons en fait accepter la phase de transition de la transition énergétique. Les efforts des décideurs publics, entreprises et consommateurs doivent être tendus vers ces objectifs, tout en soutenant de manière ciblée les technologies de demain (hydrogène, nucléaire de quatrième génération, captage, utilisation et stockage du CO2, etc.). L’Europe a de nombreux atouts pour viser pragmatiquement le Near Zero Emission en 2050. Elle pourra y parvenir si elle mobilise les forces de tous.
1. EOR = Enhanced Oil Recovery : technique de récupération assistée du pétrole.