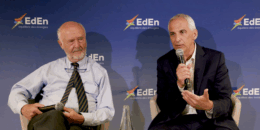La transition énergétique consiste à substituer progressivement des énergies décarbonées aux ressources fossiles. Cette substitution constitue une véritable rupture. Il ne s’agit plus d’ajouter les énergies les unes aux autres mais de se débarrasser de celles qui forment le socle de notre modèle économique depuis plus d’un siècle. Cette rupture est d’autant plus forte qu’il est clairement impossible de procéder à une substitution intégrale des énergies fossiles sans diminution de notre consommation énergétique, ce qui doit conduire à rechercher l’efficacité et la sobriété. La transition énergétique nous impose donc de repenser structurellement notre mode de développement.
Mais contrairement à la révolution industrielle ou à la révolution numérique, cette rupture-là n’est pas guidée par des opportunités de marché. Elle ne peut survenir qu’en réponse à un projet politique car ce qui la motive, ce sont les enjeux climatiques et géopolitiques, qui ne sont pas intégrés dans notre système de prix. Ce projet politique a donc un coût qui est celui d’une intervention publique massive combinant des soutiens budgétaires et fiscaux à des mécanismes de redistribution pour accompagner les ménages et les entreprises les plus exposés, et une réglementation pour engager l’investissement privé. Qu’il s’agisse de soutenir la production d’énergies nouvelles ou d’accompagner la transformation de notre manière de consommer l’énergie, le coût de la transition énergétique est incontournable, ce qui la rend très sensible aux pressions populistes qui préfèrent la fuite en avant.
La France n’échappe pas à ce débat alors que près des deux tiers de sa consommation énergétique finale repose sur des énergies fossiles qui, outre l’enjeu climatique, constituent une énorme dépendance géopolitique vis-à-vis de puissances peu amicales. La situation française n’est pas très différente, de ce point de vue, de celle des autres pays de l’Union européenne (UE). Mais tous ensemble, les 27 disposent d’un gigantesque marché intérieur qui, s’il est intelligemment protégé, permet d’opérer cette transition en permettant aux entreprises d’amortir leurs investissements de décarbonation et à la taxation du carbone, notamment aux frontières, de financer les mécanismes de redistribution rendant la transition soutenable.
Partout, le mix énergétique décarboné de demain reposera sur une électrification massive des usages (à partir d’une électricité décarbonée) et sur la couverture des besoins non électriques par la valorisation énergétique de la biomasse (bois-énergie, biogaz, biocarburants) et les solutions de chaleur et de froid naturelles (géothermie, solaire thermique, utilisation du pouvoir thermique des mers et des rivières).
Au sein de l’UE, la France dispose d’atouts remarquables pour relever ce défi car, à la différence de ses voisins, elle dispose d’ores et déjà d’une électricité décarbonée, et que le potentiel de développement de celle-ci par les énergies renouvelables (ENR) est considérable au regard du retard accumulé par notre pays sur les objectifs européens. Par ailleurs, la richesse et la diversité de notre territoire constituent une très grande réserve de biomasse.
Malheureusement, le débat sur la politique énergétique française manque singulièrement de hauteur de vue. Depuis plus de deux ans, alors qu’une stratégie énergie climat a été élaborée sous la houlette d’Agnès Pannier-Runacher, nous procrastinons à la traduire en documents programmatiques contraignants, seuls à même de fixer de façon stable les objectifs de long terme.
Cette procrastination découle de la focalisation du débat sur la question de la production d’électricité et la part relative que doivent y occuper le nucléaire et les ENR ! Cette posture bloque le débat énergétique dans son ensemble et le paradoxe est qu’elle risque de faire prendre à notre pays une bonne décennie de retard alors même que, grâce à son potentiel électrique, il est en situation de s’engager dans la décarbonation avec un temps d’avance. La cible 2050 de notre système électrique qui repose sur la combinaison de centrales nucléaires et de centrales hydrauliques avec des installations ENR, procure en effet à la France un double avantage : l’abondance et la résilience.

Commençons par l’abondance. Avec un parc nucléaire largement amorti et le développement des ENR électriques, la France dispose d’une offre abondante d’électricité à la fois à très faible contenu carbone et compétitive. Lors d’une audition récente, Bernard Fontana, le nouveau PDG d’EDF, rappelait que les prix à 5 ans pour l’électricité en France étaient inférieurs de 25 €/MWh à ceux de l’Allemagne et de 40 €/MWh à ceux de l’Italie, et ceci hors prix du CO2. C’est considérable ! Cette électricité constitue un facteur d’attractivité industrielle et de pouvoir d’achat d’une part, et elle représente un bien d’exportation qui a rapporté plus de 5 milliards d’euros à la balance commerciale l’an dernier. Ne pas profiter de cette situation pour accélérer l’électrification serait une erreur majeure. Et ce n’est évidemment pas en réduisant le rythme de développement des capacités de production des ENR que l’on enverra les bons signaux.
Les lois de l’économie sont ainsi faites qu’une offre abondante a tendance à faire baisser les prix, ce qui ne peut que faciliter l’électrification des usages. Certains tendent à nier cette réalité, à partir de l’exemple des prix négatifs. Un prix négatif survient lorsque l’offre devient supérieure à la demande parce que certaines installations font le choix économique de payer pour écouler leur production plutôt que de s’arrêter, contrairement aux installations solaires et éoliennes qui peuvent se déconnecter quasiment instantanément et sans coût. Plutôt que de pointer du doigt les ENR, il serait plus utile de libérer tous les freins afin de faire émerger de nouvelles consommations lors de ces périodes où l’électricité est disponible à coût nul, voire négatif et d’y déplacer des consommations existantes au plus grand bénéfice des producteurs et des consommateurs !
Parlons à présent de résilience. La France dispose d’un réseau de transport et de distribution de très grande qualité. Face au défi de l’électrification, ce réseau devra faire l’objet d’investissements importants, mais sans commune mesure avec les efforts que doivent déployer nos voisins (3,5 fois supérieurs en Allemagne et 2,1 fois supérieurs en Grande Bretagne selon la comparaison effectuée par Compass- Lexecon en 2024 pour RTE). La stabilité du réseau sera encore plus stratégique qu’aujourd’hui. Il sera nécessaire de se doter de systèmes plus modernes de gestion de la fréquence et de pilotage de la demande. Tous les pays y seront confrontés, mais la France, avec une production électrique qui reposera toujours sur une part majoritaire de machines tournantes (turbines nucléaires et hydroélectriques) est en bien meilleure position que beaucoup de ses voisins pour une telle gestion car elle pourra combiner la réserve inertielle avec des systèmes numériques de maintien de la fréquence, sans dépendre excessivement de l’un ou de l’autre.
À l’heure du choix, la France peut décider de sortir des polémiques électriques d’un autre âge, conforter ses atouts, et regarder l’avenir avec optimisme et fierté en s’appuyant sur sa capacité d’innovation. Mais elle peut aussi s’enfermer dans une vision rétrograde, et dans ce cas, c’est tout le système énergétique qu’elle risque d’entraîner vers le fond !