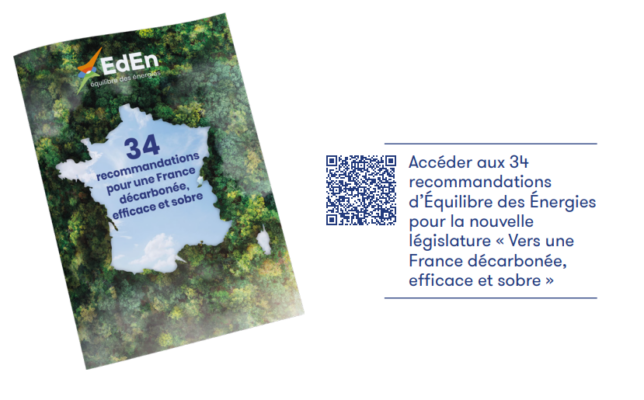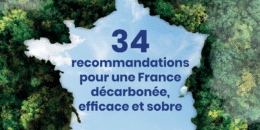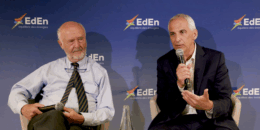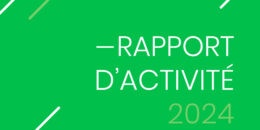Mis en circulation le 4 novembre 2024 pour une durée de six semaines, les projets de troisième Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3) et de troisième Stratégie nationale bas carbone (SNBC 3) ont fait l’objet d’une saisine quelque peu précipitée du Conseil supérieur de l’Énergie le 4 décembre 2024. Que faut-il penser de ces documents censés tracer la voie de la politique nationale énergie-climat pour les 5 ans à venir ?
Ces documents sont les résultats d’un long processus de concertation. Le résultat en est à la fois riche en information et touffu dans ses analyses et ses conclusions. On aurait souhaité que les grands objectifs proposés pour les deux périodes de cinq ans à venir soient plus clairement formulés et se retrouvent dans des bilans des consommations et des ressources énergétiques permettant de s’assurer, jusqu’à l’horizon 2035 au moins, du bouclage de l’ensemble et de prendre la mesure des évolutions par rapport aux périodes antérieures. Il a également été noté l’absence d’indicateurs de suivi comme il en était proposé dans la PPE précédente. Enfin la dichotomie entre la PPE 3 et la SNBC 3, l’une et l’autre recouvrant les mêmes périodes, impose des allers et retours entre les deux documents qui en rendent la lecture difficile.
Les grands objectifs doivent être la décarbonation, la compétitivité et la souveraineté
Primauté à la décarbonation
La PPE3 et son projet de décret d’approbation retiennent comme principe n° 1 la réduction de la consommation d’énergie finale. La France s’aligne en cela sur la doctrine défendue depuis plus de 15 ans par la Commission européenne. Mais l’urgence climatique impose que le fondement de la politique énergétique soit en premier lieu la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C’est l’objectif premier énoncé par l’article L100 1A du code l’énergie. Cette décarbonation a pris du retard et le projet de PPE reconnaît que l’économie nationale est encore dépendante à près de 60 % des énergies fossiles. La réduction des consommations ne devrait être considérée que comme l’un des moyens de réduire les émissions de gaz à effet de serre et non comme l’objectif principal.
Encore faudrait-il mieux parler d’efficacité énergétique afin de ne pas entraver le développement de l’activité économique et des nouvelles activités industrielles, comme les centres de données, la fabrication des batteries ou les raffineries de lithium, qui vont nécessiter beaucoup d’électricité décarbonée. Dans le domaine plus traditionnel des logements, la primauté excessive donnée au principe européen « energy efficiency first » conduit à fixer des objectifs très onéreux de rénovation des bâtiments, qui se révéleront probablement, faute de ressources suffisantes, inatteignables et ne permettront pas d’atteindre la neutralité carbone. Réaliser 600 000 rénovations d’ampleur en moyenne annuelle d’ici 2030 est hors de portée des moyens des particuliers et des finances publiques. L’exemple du budget 2025 de l’Anah le démontre avec un objectif de 100 000 rénovations d’ampleur seulement. Dans le même temps, on laisse au second plan le développement des pompes à chaleur qui cochent toutes les cases de la transition énergétique, permettent de réduire l’investissement de moitié et de diviser par un facteur 8 les émissions des chaudières qu’elles remplacent.

Veiller à l’efficacité économique
Le recours aux énergies renouvelables est l’autre pilier de la politique européenne repris dans le projet de PPE 3. Comme pour les économies d’énergie, les résultats ne sont pas au niveau espérés et la France n’a pas tenu les engagements qu’elle avait pris pour 2020. Pourtant, les avantages consentis aux énergies électriques renouvelables vont continuer à obérer les finances publiques pendant de nombreuses années et le projet de PPE3 évoque une charge rémanente des coûts de soutien, liés aux opérations antérieures à la PPE 3, s’inscrivant dans une fourchette allant de 37 à 105 milliards d’euros. Dans une période de crise budgétaire, il est essentiel de ne plus charger la barque. La place des énergies renouvelables dans le mix énergétique n’est pas contestée mais elles sont à présent matures, il n’y a plus lieu de les considérer comme « nouvelles », il faut les repositionner dans le cadre naturel du fonctionnement de l’économie, rémunérer les kWh produits à leur valeur réelle pour l’économie et soutenir les investissements par d’autres voies que les incitations financières, en simplifiant les procédures et en favorisant les équipements qui permettent de piloter les consommations au moment où l’énergie est abondante.
Les prévisions de développement des moyens de production d’électricité d’origine solaire ou éolienne correspondent à horizon 2035 à un quadruplement des puissances installées. Les objectifs avancés par la PPE de 6,5 GW d’électrolyseurs installés en France en 2030 – sans que l’on sache quels seront les utilisateurs de l’hydrogène produit — et de 44 TWh de biométhane injectés dans le réseau dès 2030, avec une perspective pouvant aller jusqu’à 79 TWh en 2035, semblent à Équilibre des Énergies très ambitieux et de nature à entraîner des charges budgétaires trop élevées. Il est noté en particulier que le projet initial de loi de finances pour 2025 retient une hypothèse de soutien au gaz renouvelable de 100 €/MWh injecté. Les perspectives de progrès technique sur cette filière sont limitées. Les objectifs avancés pour 2030 et 2035 peuvent donc se traduire, de façon récurrente, par des charges budgétaires additionnelles de 4 à 8 milliards d’euros par an pendant 20 ans.
A contrario, les possibilités de développer les actions d’efficacité énergétique rentables pour la collectivité ne sont pas épuisées. Le cas des pompes à chaleur a été évoqué. Il conviendrait également d’encourager la massification des systèmes de gestion de l’énergie, en particulier les systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments (BACS en anglais) qui constituent un choix sans regret.
Renforcer la souveraineté énergétique
La PPE annonce une réduction par rapport à 2012 de la consommation d’énergies fossiles primaire de 53 % en 2030 et de 65 % en 2035. Ces chiffres sont encourageants et doivent être soutenus. Malheureusement le projet de décret ne retient que des objectifs de -45 % et – 60 %. Cet écart important devra être expliqué.
Par ailleurs, le recours à des filières décarbonées ne doit pas se traduire par la création de nouvelles dépendances. On connaît le problème des panneaux photovoltaïques et des matériaux stratégiques. Il faut veiller à ne pas laisser se créer de nouveaux circuits de dépendance pour l’hydrogène et les nouveaux carburants de synthèse. Dans le même temps, une attention particulière est à porter pour consolider les secteurs industriels où la France est un acteur historique comme le nucléaire ou les réseaux électriques (transformateurs, relais, disjoncteurs, automates, matériels de ligne, boîtiers, connectique, etc.) et maximiser les retombées économiques.
Compléter la PPE par un plan d’électrification
Il est reconnu, en Europe comme en France, que l’électrification des usages est le moyen le plus efficace pour progresser dans la voie de la décarbonation de l’économie. Elle permet, ce faisant, d’améliorer l’efficacité énergétique, grâce notamment aux pompes à chaleur, au véhicule électrique et aux systèmes de gestion automatisée de l’énergie. La PPE3 vise une part de l’électricité dans la consommation finale d’énergie dépassant 50 % : Équilibre des Énergies soutient cette ambition. Mais cette nouvelle électrification de l’économie n’a pas commencé et la part d’électricité dans la consommation d’énergie finale stagne aux environs de 27 %.
Pourtant l’énergie électrique est disponible et il serait plus avisé d’en tirer parti sans tarder pour l’économie nationale plutôt que de l’exporter dans des conditions qui ne sont pas toujours très valorisantes.
Cette situation appelle donc un plan d’action qui devrait venir compléter la PPE 3. Un tel plan devrait notamment comporter :
- des mesures de nature à stimuler la migration vers les solutions électriques :
- incitations financières à la mutation vers des procédés industriels électriques (pompes à chaleur haute température, compression mécanique de vapeur, fours électriques, etc.) ;
- accélération de la mutation vers la mobilité élec- trique, y compris dans les poids lourds, sans préjudice du rôle que pourra jouer le bioGNV. À ce titre, le déploiement des infrastructures de recharge sur les autoroutes est un point clé. Aujourd’hui, le soutien public, estimé à 5 Mrd€, est essentiel dans les différents segments compte tenu du manque de rentabilité des investissements (pointe estivale pour les véhicules légers et amorçage pour les poids lourds). Le concept de schéma directeur, qui a fait ses preuves pour les collectivités, a tout intérêt à être répliqué sur les autoroutes. Pour limiter les investissements publics, Équilibre des Énergies propose de déplafonner les contrats des opérateurs sur les autoroutes concédées, à l’instar des règles existantes pour les autoroutes non concédées, pour faciliter l’amortissement dans le temps ;
- levée des obstacles réglementaires à l’usage de l’électricité dans les logements (la PPE 2 avait ramené le coefficient de conversion de l’énergie primaire de 2,58 à 2,3, la PPE 3 devrait le ramener à 1,9 suivant en cela les préconisations retenues au niveau européen) ;
- alignement de la fiscalité des énergies sur les objectifs de décarbonation ;
- introduction dans le décret tertiaire un critère carbone, à l’instar du DPE, fondé sur les émissions de CO2, est à considérer pour contribuer à valoriser l’électrification des usages ;
- des programmes d’adaptation et développement des réseaux de transport et de distribution tel qu’identifiés par RTE et Enedis ;
- une confirmation du lancement des six nouveaux réacteurs EPR2 suivis des huit également envisagés aujourd’hui. Les incertitudes sur le redémarrage de la croissance des consommations d’électricité ne doivent pas servir à justifier la procrastination et le lancement des nouveaux réacteurs nucléaires ne doit surtout pas être la variable d’ajustement des programmes d’investissement. Nous bénéficions aujourd’hui des investissements réalisés il y a 40 ans. Les nouveaux réacteurs qui seront en service à partir de 2035 le resteront jusqu’à la fin du siècle. Ils forgeront la France moderne qui abritera les générations futures.

Développer la chaleur renouvelable
Équilibre des Énergies note avec satisfaction l’importance de la place que la PPE 3 entend réserver à la chaleur aérothermique captée par pompes à chaleur. Les quantités récupérées pourraient ainsi passer de 41 TWh en 2022 à 77 voire 101 TWh en 2030. Équilibre des Énergies confirme son souhait de voir retenu un objectif de 10 millions de logements chauffés par pompes à chaleur en 2030 avec une perspective minimale de 60 % des logements équipés en pompes à chaleur en 2050. Elle estime que les solutions de PAC air/air devraient être davantage prises en considération et soutenues, notamment pour permettre la conversion d’une proportion significative des logements aujourd’hui chauffés au fioul, au gaz ou par convecteurs électriques. Dans le collectif, des solutions existent également : elles doivent continuer à être développées sans exclure les solutions hybrides lorsque la configuration des lieux l’y conduit.
La géothermie est très certainement une solution à promouvoir dans le cadre de la PPE 3 qui s’agisse de géothermie profonde ou de géothermie de surface associée, s’il y a lieu, à des systèmes de remontée de la température par pompes à chaleur et de stockage inter-saisonnier.
Équilibre des Énergies appelle l’attention sur l’ampleur à donner au développement des réseaux de chaleur. La géothermie, les chaleurs de récupération et la valorisation des déchets sont clairement des solutions à promouvoir, souvent de façon coordonnée . On peut cependant être beaucoup plus circonspect sur l’utilisation des énergies fossiles et aussi de la biomasse comme combustible car celle-ci devrait être réservée à des usages plus valorisants.

Les nouveaux carburants
Les solutions électriques pourront répondre à une grande part des besoins de mobilité. Cependant, la décarbonation des secteurs aérien et maritime ainsi que celle des engins agricoles et de chantiers restera un problème difficile. Ces questions sont abordées de façon trop marginale dans le projet de PPE 3. Les nouveaux règlements européens ReFuelEU Aviation et FuelEU maritime fixent un cadre pour le développement des biocarburants et des carburants de synthèse mais il n’existe pas aujourd’hui de plan industriel de développement de ces carburants en France, comme en Europe.
Il serait illusoire d’imaginer que la France puisse atteindre l’autonomie dans ces domaines mais un plan de développement devrait être arrêté avec des objectifs compatibles avec les intrants qui pourront être mobilisés pour la fabrication de ces carburants. Les ressources en électricité nécessaires doivent être prises en compte dans la planification des moyens de production et les ressources en biomasse devront faire l’objet d’une priorisation en direction des usages où elle est indispensable. La récupération du carbone, industriel puis biogénique, devra être encouragée.

Priorisation des usages de la biomasse
Par rapport à la PPE 2 et à la SNBC 2 , la prise de conscience de la limitation des ressources en biomasse durable, associée à une réévaluation plus réaliste des puits de carbone, est l’un des éléments les plus contraignants de la PPE 3 et de la SNBC 3. La biomasse durable est une ressource rare : ce sont des molécules carbonées mais intrinsèquement porteuses d’un crédit carbone. Se contenter de les brûler dans une chaudière, pour alimenter des réseaux de chaleur ou au travers du biométhane, ne peut pas être considéré comme une utilisation vertueuse à promouvoir. Elle ne peut être admise que lorsque les circonstances locales le justifient. Équilibre des Énergies invite les pouvoirs publics à se montrer plus sélectifs dans les usages de la biomasse qui seront encouragés au cours de la prochaine décennie.
Gestion industrielle du carbone
Le captage et le stockage du carbone (CCS) et a fortiori le captage et l’utilisation du carbone (CCU) étaient considérés dans la SNBC 2 comme des techniques à n’envisager qu’en dernier recours, de façon à ne pas porter préjudice à la réduction des émissions. Dans la SNBC 3, le CCS devient l’une des composantes de la politique de décarbonation de l’industrie, avec l’objectif de récupérer et de stocker géologiquement quelque 6,6 millions de tonnes de CO2 dès 2030. À horizon 2050, le déploiement du CCS et du CCU pourrait permettre de récupérer de 31,4 à 57,9 millions de tonnes de CO2 dont 60 % environ d’origine biogénique générant des crédits carbone.
Il y a encore beaucoup d’incertitudes sur le développement de ces techniques qui ont largement progressé en termes de maturité technologique mais sont encore éloignées de l’équilibre économique sur la base des prix actuels du CO2 (65 €/t). Équilibre des Énergies pense que la prochaine période quinquennale de la PPE ne verra sans doute pas se développer à grande échelle le CCS et le CCU mais devrait être mise à profit pour maîtriser l’ensemble de la chaîne et se tenir prêt à un développement industriel à partir de l’année 2030, si le prix du carbone a repris son orientation à la hausse.

1e financement : les CEE, un outil clé
Le contexte budgétaire actuel, notamment sur le manque de visibilité des aides publiques, est un élément bloquant de la transition. Dans ce contexte, les certificats d’économies d’énergie (CEE) sont un outil essentiel de la maîtrise des consommations et par extension de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Pour assurer l’acceptabilité sociétale Équilibre des Énergies appelle à statuer, rapidement, sur un niveau d’obligation globale réaliste, entre 825 et 1 250 TWhcumac/an, porté par de nouveaux gisements, en premier lieu dans les transports et l’industrie et la levée des obstacles à l’électrification. La création de fiches d’opération standardisées à l’attention des flottes professionnelles, qui effectuent de nombreux kilomètres, doit constituer la priorité. À ce titre, Équilibre des Énergies appelle à modérer l’inclusion d’objectifs programmatiques législatifs ou réglementaires afin de ne pas bloquer la possibilité de soutien via les CEE.
La question de la confiance dans le dispositif, en particulier dans le résidentiel, est également un point clé pour l’acceptabilité. Équilibre des Énergies appelle les pouvoirs publics à s’intéresser aux actions menées par ses voisins européens afin de sanctionner plus sévère- ment les fraudes sans ralentir outre mesure le processus de versement des subventions.